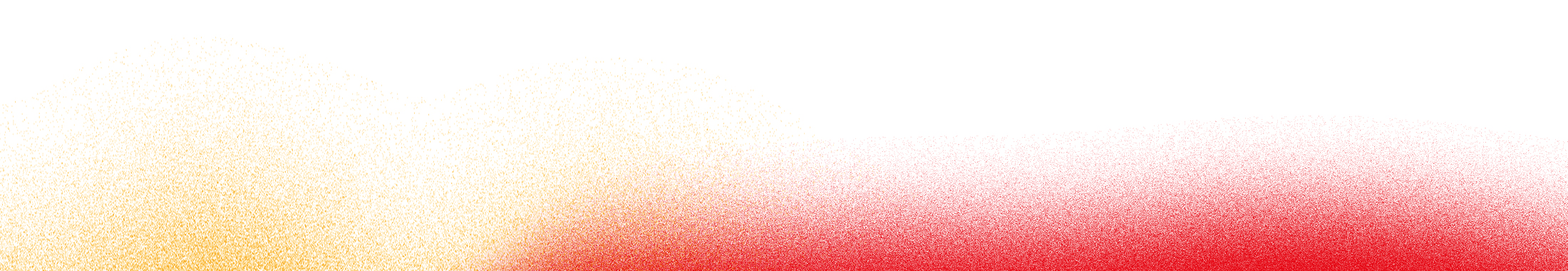Étang de la Gruère
Passé
Roger Châtelain
Étang de la Gruère, 1953
Peinture à l’huile, 82 x 102 cm
Inv. 4489
Collection jurassienne des beaux-arts, Porrentruy
Présent
Roger Meier
Étang de la Gruère, 2012
Photographie (tirage original), 70 x 50 cm
Collection privée
Futur
Sylvie Aubry
Mes essais : étang de la Gruère et poème de Gilles F. Jobin, 2024
Technique mixte, 42 x 30 cm
Collection de l’artiste
Sylvie Aubry. Une image qui résonne dans la mémoire de ses doigts
Sylvie Aubry (*1952) est une artiste plasticienne et bijoutière jurassienne. Elle vit et travaille au Noirmont. La nature dans toute sa diversité, mais aussi dans ses bouleversements actuels, est sa principale source d’inspiration.
Actuellement, j’imbrique des ronds ou enfile des trous, des passages dans une feuille de papier, imaginant la réalité, essayant de trouver dans la mémoire de mes doigts une image qui résonne dans de multiples lectures, un équilibre ou un mouvement qui réjouisse l’esprit et allège la vie. Je m’approche de l’abstraction.
Un jour, il y a quelques années, je me suis intéressée à l’Étang de la Gruère, vu du ciel.
La fluidité de la forme noire de l’eau m’a surprise, propre à suggérer histoires et fantasmes. Elle m’a paru étrange, bizarrement belle, elle m’a agacée, car au premier regard, j’y voyais un animal en mouvement, une figure d’un autre temps.
L'étang porte l’empreinte de la mutation lente de la tourbe. Des traces qui renvoient chacun à son vécu et qui peuvent être interprétées... ou non.
J'ai voulu voir où cette forme m’entraînerait. Du noir de la tourbe a surgi la couleur.
Le processus ?
Je pose un regard très simple sur les paysages. Des signes se forment sous mes doigts les rythmes deviennent visibles. Je note des informations : indications de mouvements, de stabilité, de verticalité, de perspective. Ainsi, s’installe une interprétation personnelle, faite de gestes d'aujourd'hui et de motifs géométriques abstraits.
Les vents soufflent indifférents au temps.
Sylvie Aubry
Pour aller plus loin
Les sphaignes, bâtisseurs de tourbière
Les sphaignes sont les mousses des tourbières et leurs magnifiques couleurs illuminent ces petits paysages d’aspect nordique. Passées maîtres dans l’art de créer leur environnement, elles garantissent leur survie en stockant l’eau, en acidifiant le milieu et en l’appauvrissant en matières nutritives, ce qui rend ce dernier hostile aux autres espèces. Une fois mortes, les sphaignes continuent de stocker l’eau et les éléments nutritifs tout en se transformant en tourbe. Seules les parties basales meurent, alors que les parties apicales continuent de croître indéfiniment. L’acidité du milieu empêche la croissance des bactéries et des champignons, qui jouent habituellement le rôle de décomposeurs de la matière végétale. Cette acidité, jointe au manque d’oxygène dû à la saturation en eau, ralentit fortement la décomposition des sphaignes. Lorsque leur taux de croissance est plus fort que leur taux de décomposition, la tourbe s’accumule. Cette accumulation est très lente, de l’ordre de 0,3 à 1 mm par an à la tourbière de la Gruère selon les sondages. Une épaisseur de tourbe de 7,92 mètres y a été mesurée, ce qui lui confère un âge de près de 10’000 ans à cette extraordinaire tourbière.
Il existe une trentaine d’espèces de sphaignes en Suisse, qui se répartissent au sein des écosystèmes selon trois gradients : humidité, teneur en substances nutritives et lumière.
Grâce à leur capacité de stockage de l’eau, certaines espèces peuvent stocker jusqu’à 30 fois leur poids en eau, faisant les tourbières de véritables éponges. Aux Franches-Montagnes, ce plateau sans rivières, elles furent utilisées dès le 17ème siècle pour leur potentiel hydrique. Par un système de drainage, les eaux étaient collectées dans l’étang situé en contrebas, puis dirigées vers la scierie ou le moulin, où elles jouaient leur rôle de force motrice, avant de se perdre dans une doline. La dernière scierie à fonctionner de cette manière, celle de la Gruère, a été électrifiée dans les années 50. Des étangs, avec les vestiges de construction qui leur étaient associés, s’observent encore aujourd’hui aux Royes, à la Chaux-des-Breuleux, à Plain de Saigne et à la Chaux d’Abel.
Archives vivantes et puits de carbone
Les tourbières, du fait de l’acidité et du manque d’oxygène de la tourbe, conservent la matière organique sans la dégrader et constituent de ce fait des archives vivantes.
Au niveau mondial, les tourbières stockent 3 fois plus de carbone que toute la biomasse terrestre.
Elizabeth Feldmeyer-Christe, Dr ès sciences, biologiste
Tourbière de la Chaux-des-Breuleux © Elizabeth Feldmeyer-Christe
Sphagnum angustifolium © Elizabeth Feldmeyer-Christe