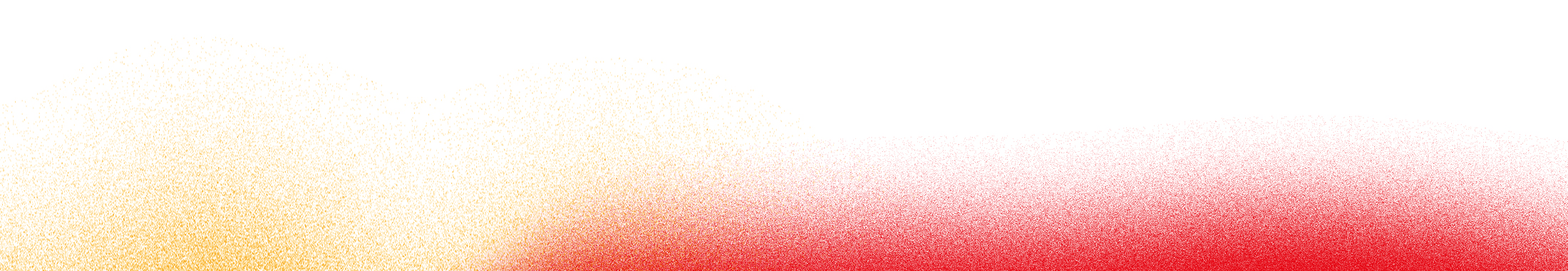Sur la crête
Comment avez-vous trouvé les paysages jusqu’ici? Avez-vous noté les dépressions qui se trouvaient le long du chemin entre Le Noirmont et le Creux des Biches?
Il s’agit de dolines ou emposieux, des éléments caractéristiques du paysage des Franches-Montagnes. Le sentier vous a ensuite fait prendre quelques mètres d’altitude. Il faut dire que vous passerez dans quelques minutes à proximité du troisième point le plus haut du canton, Le Point de Vue qui culmine à 1 185 m. Pas étonnant qu’on ait installé ici des éoliennes.
Lorsque vous arriverez au Peu Girard, veillez à suivre la route et pas le balisage, sinon vous manquerez le dernier cadre…
Toponymie
Il ne vous aura pas échapper que les noms des localités des Franches-Montagnes diffèrent beaucoup du reste du territoire cantonal. Aucun village en « court » sur le haut-plateau, mais toute une série de noms précédés de déterminants. Curieux hasard, vous dites-vous ? Il n’en est rien. Mais pour décrypter les secrets de ces noms de lieux, il faut se tourner vers la toponymie, la science qui les étudie.
Les noms des localités que l’on connaît aujourd’hui n’ont évidemment pas tous été donnés à la même époque. Logiquement, les toponymes témoignent des langues parlées dans ces lieux, mais également de certaines modes. Chevenez, par exemple, est un nom de lieu dont l’origine remonte à l’époque gallo-romaine. Des fouilles réalisées en 2012 ont d’ailleurs permis de mettre au jour un site de période romaine remontant au Ier siècle après J.-C. Ce toponyme est composé d’un nom propre gallo-romain, Cavinius, auquel on ajoute le suffixe bien répandu -acum : Chevenez signifie donc « la propriété de Cavinius ».
Au VIe siècle, on crée des noms de lieux en utilisant le mot latin cohortem (« exploitation agricole, hameau ») que l’on retrouve sous la forme cour-. Lorsque l’élément se trouve au début du mot, comme dans Courroux ou Courtedoux, cela tend à signifier que le lieu a été fondé au début du VIe siècle. En revanche, si l’élément est situé en fin de mot, comme dans Bassecourt ou Bressaucourt, le village daterait plutôt de la fin VIe siècle. Au VIIe siècle, c’est l’adjectif latin villaris (« de la ferme ») qui entre en jeu, comme dans Villars, Epauvillers ou Montsevelier.
Et les noms propres avec article des Franches-Montagnes que l’on retrouve dans Les Breuleux, La Bosse Le Peuchapatte ou Les Pommerats ? Ils reflètent la colonisation tardive du haut-plateau. La langue latine n’avait pas d’article. Ces derniers apparaissent dans les langues romanes à partir des VIIIe-IXe siècles. Toutefois, cela ne signifie pas que ces villages soient aussi anciens. Les localités avec article des Franches-Montagnes ont probablement été fondées plus tard, à partir du XIe siècle. Les premières attestations dans des sources écrites apparaissent en 1330, avec Le Bémont, La Bosse, Les Enfers et Le Praisselet.
Élodie Paupe, responsable du site Jura-24 des Franches-Montagnes
Des éoliennes sur les hauteurs
La balade retrouve ici un sentier didactique mis en place par le groupe Alpiq. Intitulé "Dans le vent", il est jalonné de panneaux pédagogiques. Un dépliant est disponible ici.
Le parc éolien du Peuchapatte a été mis en service en 2011. Il produit en moyenne 13,5 GWh/an, soit l’équivalent d’environ 4’000 ménages, ce qui équivaudrait selon Alpiq à environ 3% de la consommation électrique du canton du Jura. Il faut dire que le site profite des vents réguliers et forts de la région qui garantissent une production d'énergie stable et fiable.
Comme pour de nombreux projets éoliens, le site du Peuchapatte a dû faire face à des défis en matière de protection de la faune et de l'impact visuel sur le paysage. Toutefois, des mesures d'atténuation ont été mises en place pour minimiser ces impacts. Des études menées sur les oiseaux et les chauves-souris ont ainsi permis de démontrer que le bruit et les ondes produites par les infrastructures n’avaient que peu d’impact sur la faune.
Cultiver des céréales aux Franches-Montagnes?
Par les siècles passés, l’existence de moulins atteste de cultures de céréales pour la farine à Soubey, aux Breuleux, aux Bois, à L’étang de Plain de Saigne dont les maitres-meuniers répondaient au doux nom de Farine !
La production de céréales s’est toujours pratiquée dans les Franches-Montagnes mais sur des surfaces très restreintes, avec, en général, pour objectif principal de rénover les prairies de fauche. Les céréales fourragères de printemps (avoine et orge) étaient principalement cultivées jusque dans les années 1980. Ensuite, les premières variétés de triticale d’automne, très rustiques, ont été cultivées avec succès.
Plus tard, d’autres céréales d’automne ont été mises en culture comme le blé fourrager, l’orge et finalement le blé panifiable. Avec les changements climatiques, les hivers plus doux et l’allongement de la période de végétation, la production de céréales permet actuellement d’obtenir des rendements quasi comparables à ceux de la plaine. Par ailleurs, avec les innovations techniques telles que le semis direct et le travail du sol réduit, il est devenu plus aisé de cultiver des céréales dans nos sols souvent pierreux et superficiels.
La production de céréales sur place a pour avantages d’augmenter l’autonomie fourragère des exploitations agricoles, de faciliter la rénovation des prairies et de diminuer les besoins d’importation en paille de litière pour les animaux d’élevage. Elle permet également d’augmenter la production végétale à destination alimentaire comme le veut la politique agricole actuelle.
La part des cultures de céréales dans la surface agricole utile est passée de 2.4% en 2010 à 3.3% en 2022. Parmi ces céréales, le blé est passé de 10 à 20%.
Julien Berberat, Fondation Rurale Interjurassienne